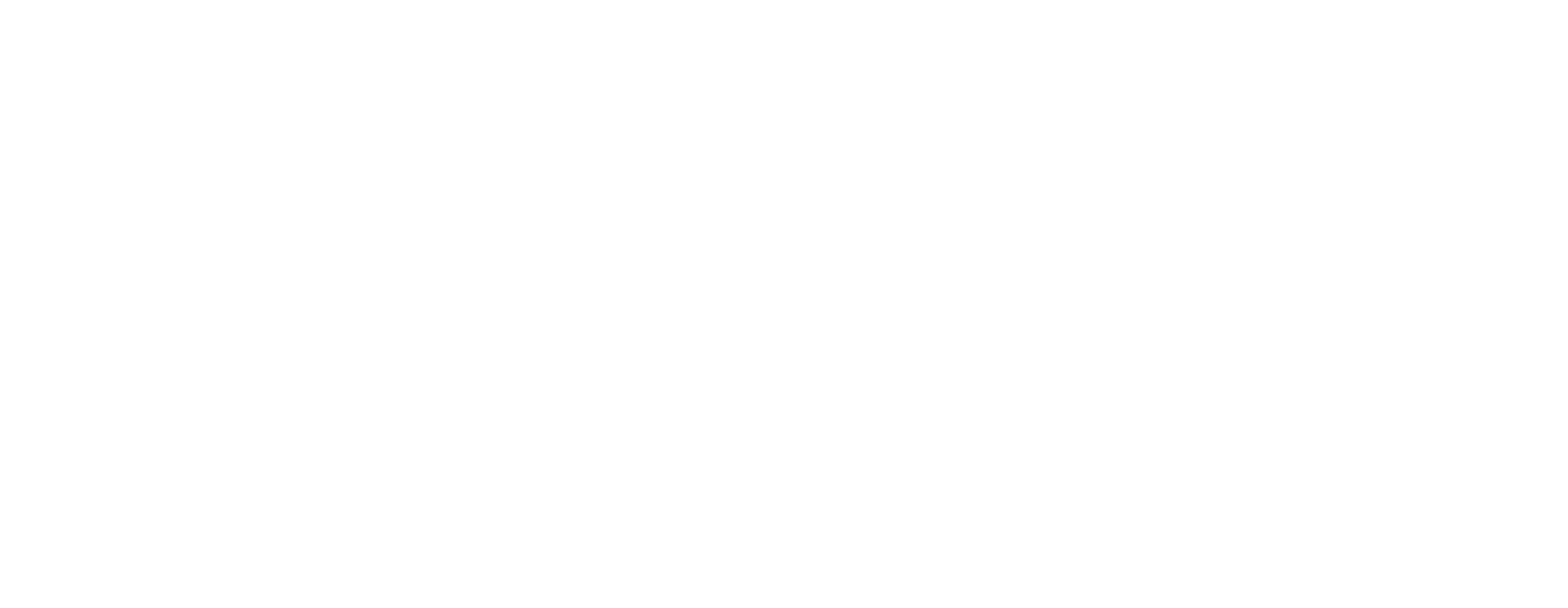Patrimoine
Patrimoine

ÉGLISE de PANAZOL : ST-PIERRE-ÈS-LIENS
« Saint-Pierre-es-Liens » ou « aux Liens » fait référence au récit de l’emprisonnement de Pierre à Jérusalem par le roi Hérode Agrippa en l’an 43.
L’église de Panazol, le plus ancien monument de la commune, a une histoire riche qui remonte au XIème sous la forme d’une église romane. Il a fallu attendre le XIIIème et une reconstruction majeure pour que l’édifice adopte un style gothique.
L’église romane primitive, de forme rectangulaire, était rattachée à l’Abbaye Saint-Martial de Limoges. De cette première construction, il ne reste que quelques vestiges : des contreforts, des corbeaux encastrés dans le mur sud et une petite partie de la voûte en berceau, en avant du chœur.
Au fil du temps, l’église a évolué grâce à de nombreux travaux, notamment au XVème, où un chevet fut construit ainsi que la chapelle méridionale.
Lors de l’année 1513, deux pans de mur furent ajoutés au sud, entre la chapelle précédente et un contrefort, dans le but de constituer une seconde chapelle. Au XVIIIème, la sacristie et le Presbytère ont été bâtis. Au XIXème, la troisième et dernière chapelle a été édifiée, côté nord de l’Eglise.
Depuis le début du XXème, de nombreux travaux de consolidation et de restauration ont eu lieu. Le changement récent le plus notable est le retrait du crépi en 1991 pour laisser les pierres apparentes.
MAIRIE
L’histoire de cette magnifique bâtisse du 19ème siècle se confond avec celle de la commune de Panazol.
Le château de la Beausserie fut achevé de construire en 1861 à la demande de Guillaume Guybert de la Beausserie. Construit à près de 500 mètres du bourg de Panazol, ce qui prouve selon P. Grandcoing dans son ouvrage (Demeures et distinction des châteaux et châtelains au 19ème siècle en Haute Vienne) « une volonté de distanciation entre le château et le village, entre le châtelain et les villageois, voire ici entre le château et la maison ancestrale des Guybert de la Beausserie située au centre du bourg ».
Le Limougeaud Joseph Texier est le concepteur du château construit en pierre de la région et en briques (parement et briques pleines). Le choix de ce style a été fait afin de distinguer le château du bâti environnant grâce aux jeux des couleurs et à la polychromie de l’édifice. Cinq châteaux de ce type furent construits : la Beausserie 1861, Valmath 1862 (commune d’Ambazac), le Boucheron 1886 (commune de Bosmie l’Aiguille), les Combes 1874 (commune de Dompierre-les-Églises), le Bréjoux 1887 (Commune de Solignac).
Le fils de Guillaume de la Beausserie, Alfred, a hérité du château mais il ne venait que de temps en temps car il était conseiller à la Cour des Comptes à Paris. Les Guybert de la Beausserie étaient une famille bourgeoise puissante et riche qui possédait 17 hectares de terres cultivables autour du château. Des fermiers métayers s’occupaient de ces terres. Il faut savoir que cette famille participait beaucoup à la vie locale et qu’ils sont devenus élus municipaux (dont un Maire).
Les Guybert de la Beausserie ont vendu le château au Comte O’Toole qui était aussi propriétaire du château de la Quintaine. Sa fille, Mme de Beaulieu, aimait beaucoup la Beausserie mais le château a été vendu à Mme Antoinette Fischer en 1937 pour la somme de 200 000 anciens francs.
En 1945, le château a été vendu 3 050 000 anciens francs à l’Aide Sociale Militaire pour installer une colonie de vacances.
17 ans plus tard, Le 10 septembre 1962, le maire Pierre Guillot en fait l’acquisition, moyennant la somme de 230 000 nouveaux francs. Plusieurs travaux d’aménagement vont être réalisés, et c’est ainsi qu’en 1969, le Château devient la Mairie.